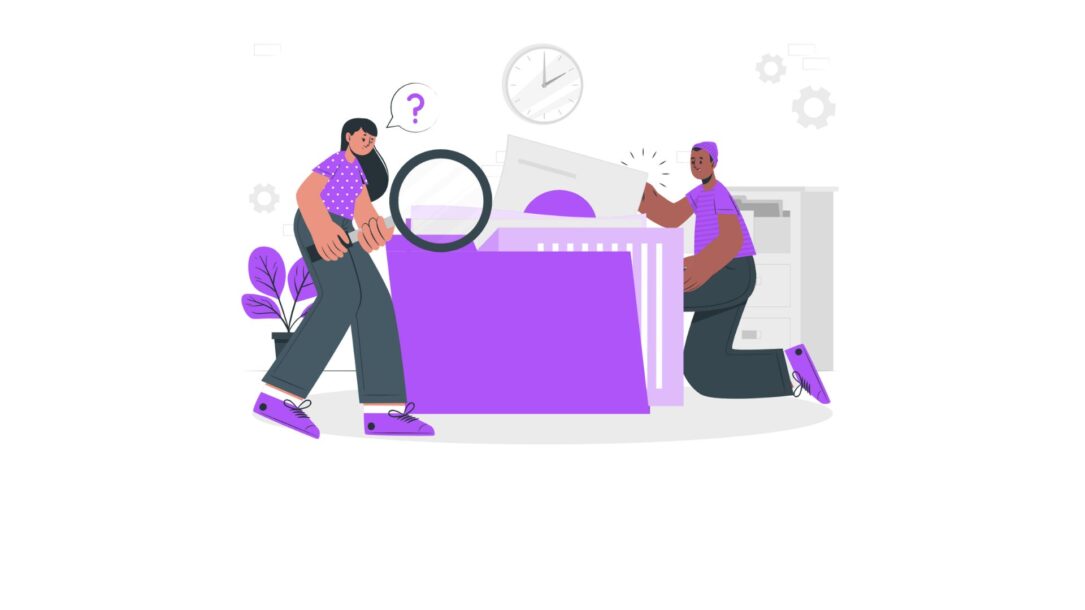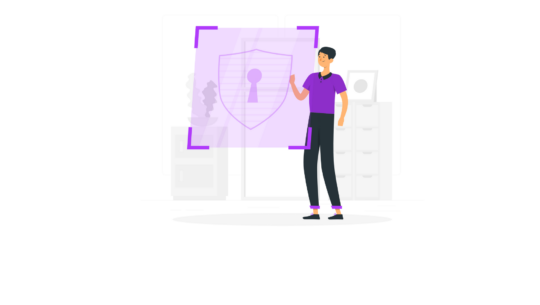Dans la fonction publique, les directions des ressources humaines jouent un rôle central mais souvent contraint par la lourdeur administrative.
Gestion statutaire, conformité réglementaire, suivi des effectifs : autant de missions essentielles, au cœur des responsabilités RH, mais souvent très consommatrices de temps et d’énergie. Cette charge opérationnelle peut parfois limiter la disponibilité nécessaire pour développer pleinement une approche stratégique à plus long terme, notamment dans un contexte de transformation accélérée des organisations.
Et si l’intelligence artificielle générative (IAG) offrait l’opportunité de renforcer encore davantage le rôle stratégique des ressources humaines dans le service public, en leur donnant de nouveaux leviers pour anticiper les besoins, accompagner les transitions professionnelles et piloter les compétences de façon plus fine ?
Des services RH principalement mobilisés sur des missions administratives
Le quotidien des équipes RH reste naturellement structuré autour de leurs missions fondamentales : gestion des carrières, conformité réglementaire, traitement administratif. Ces tâches essentielles assurent le bon fonctionnement des organisations publiques. Toutefois, cette charge opérationnelle mobilise fortement les ressources disponibles, ce qui limite les marges de manœuvre pour investir d’autres dimensions de la fonction RH, notamment son rôle stratégique en matière d’anticipation, d’accompagnement du changement ou de gestion des compétences à moyen terme. Or dans un contexte de transformation rapide des métiers, d’évolution des attentes des agents et de complexification des politiques publiques, la capacité à anticiper les besoins en compétences devient un levier pour assurer la continuité du service, accompagner les parcours et soutenir la modernisation des organisations.
Résultat : les équipes en charge de la gestion des ressources humaines font encore face à des défis pour faire pleinement évoluer leur posture de partenaires stratégiques, notamment dans un contexte où les outils et pratiques liés à l’intelligence artificielle générative sont encore en cours d’appropriation.
Cette situation alimente une double difficulté :
- D’un côté, un écart peut être observé entre les ambitions de modernisation affichées par certaines organisations publiques et les pratiques RH réellement mises en œuvre, qui demeurent parfois contraintes par des procédures établies et des marges de manœuvre limitées.
- De l’autre, les attentes des agents en matière d’accompagnement individualisé, de mobilité ou de développement des compétences ne trouvent pas toujours des réponses suffisamment adaptées à la diversité des parcours et des situations professionnelles.
C’est à l’intersection de ces deux constats que l’intelligence artificielle générative pourrait offrir un appui complémentaire à ces évolutions, en soulageant les équipes RH de certaines tâches administratives quotidiennes. Les équipes pourront alors dégager du temps pour se consacrer davantage aux stratégies. Mais également, l’IAG pourra se positionner comme une aide à la décision stratégique en support aux réflexions des équipes.
L’IA générative, un levier d’anticipation et d’aide à la décision
L’IAG peut agir comme un soutien opérationnel en automatisant les tâches répétitives telles que la comparaison des profils avec les attendus des postes à pourvoir, l’aide à la rédaction de courriers, l’extraction de données ou la génération de notes et de synthèses. Elle pourrait permettre, à terme, de produire une cartographie dynamique des compétences en croisant les données internes issues des parcours, formations ou évaluations, avec des données externes comme les tendances du marché ou les offres d’emploi, offrant ainsi une vision actualisée des compétences disponibles et de celles à développer. L’IA générative peut également proposer des scénarios de mobilité et de formation en identifiant les compétences transférables d’un métier à un autre. Enfin, elle soutiendrait les prises de décision stratégiques en simulant, par exemple, l’impact d’un départ massif à la retraite, d’une réorganisation de service ou du lancement d’une nouvelle politique publique sur les compétences requises. Pour une vision plus globale des effets de l’IAG sur les métiers et compétences dans la fonction publique, voir aussi l’article : L’IA Générative dans les administrations : quels impacts sur les métiers et les compétences ?
Prenons l’exemple des passerelles de mobilité : un agent administratif possédant des bases solides en analyse de données pourrait être identifié comme profil pertinent pour rejoindre une équipe de contrôle de gestion, sur base d’un calcule de niveau de compétences communes.
Dans un environnement riche en données et en parcours diversifiés, ce type de correspondance peut s’avérer difficile et long à détecter avec les seuls outils traditionnels. L’IA générative permet ici de croiser rapidement des informations issues de sources multiples et de suggérer des liens de compétences qui, sans être invisibles, demanderaient davantage de temps et de ressources humaines pour être repérés manuellement. Avec elle, les DRH pourraient gagner en visibilité et en capacité de projection.
Du gestionnaire de procédures au stratège des compétences
Le rôle des DRH publiques se transforme. Elles sont, en plus d’être les garantes de la conformité réglementaire ou les gestionnaires des effectifs, également des acteurs centraux de la transformation des organisations. Leur mission s’étend bien au-delà de l’application des procédures : elles sont appelés à concevoir, piloter et incarner une véritable stratégie des compétences à l’échelle de la collectivité.
L’alignement entre besoins organisationnels et aspirations individuelles constitue déjà une dimension essentielle du rôle des DRH. L’IA générative ne transforme pas cette mission, mais elle peut en faciliter la mise en œuvre, notamment en identifiant plus rapidement les passerelles possibles entre métiers, en valorisant les compétences transférables et en rendant plus visibles les opportunités de mobilité ou de reconversion. Cette approche implique de passer d’un raisonnement en silos à une vision plus transversale des compétences, capable d’identifier les passerelles possibles entre métiers et de valoriser les compétences transférables.
Les DRH sont également en première ligne pour piloter la gouvernance de la donnée RH, souvent considérée comme un actif stratégique à part entière dès lors qu’elle est correctement structurée, sécurisée et exploitée. Elle peut en effet contribuer à créer de la valeur pour l’organisation, au même titre que les compétences, les outils ou les ressources financières. Cette valeur peut se traduire de plusieurs manières : par une meilleure identification des compétences disponibles ou à développer, par une mise en cohérence plus fine entre les profils internes et les besoins à venir, ou encore par une capacité accrue à réagir face aux départs, aux évolutions de métiers ou aux réorganisations.
Cela implique de garantir la qualité, l’accessibilité et la sécurité des données RH, tout en veillant à leur traitement éthique et conforme au RGPD. Dans cette perspective, la donnée ne devrait pas être perçue uniquement comme une contrainte technique liée à la nécessité de l’alimenter et de la mettre à jour, un exercice encore peu systématisé dans de nombreuses organisations publiques, mais comme un levier stratégique, au service du pilotage, du dialogue entre les acteurs et de l’anticipation des évolutions. Ces enjeux de gouvernance et de valorisation de la donnée RH ont été approfondis dans l’article : De la GPEC classique à la GPEC prédictive : pourquoi les données sont la clé de l’intégration de l’IA générative dans le secteur public ?
Les professionnels RH doivent par ailleurs jouer un rôle moteur dans la transformation culturelle liée à l’IAG, car le pilotage des politiques de formation et l’accompagnement des évolutions des métiers est de leur ressort. Ils sont en première ligne pour faire le lien entre innovation technologique et réalités humaines du travail. Ce rôle ne consiste pas à former eux-mêmes les agents, mais à mettre en place les conditions favorables à l’acculturation : en facilitant l’accès à des actions de sensibilisation, en identifiant les bons interlocuteurs, en mobilisant des experts ou en intégrant ces enjeux dans les lignes directrices de gestion. Il leur revient aussi de porter ces sujets en interne, d’ouvrir des espaces de dialogue sur les usages et de veiller à ce que les préoccupations des agents, qu’elles soient techniques, éthiques ou professionnelles, soient entendues et prises en compte. Il s’agit ainsi de contribuer à un climat de confiance, propice à une appropriation progressive des outils, sans minimiser les enjeux, ni précipiter les changements.
Enfin, les DRH devraient se positionner comme des partenaires stratégiques des décideurs publics. Grâce à leur connaissance fine des métiers, des compétences et des dynamiques internes, elles sont en mesure de formuler des scénarios prospectifs, d’anticiper les impacts des politiques publiques sur les ressources humaines, et d’orienter les choix en matière de formation, de recrutement ou d’organisation du travail.
En d’autres termes, les DRH pourraient passer du rôle de « gardiens des statuts » à celui de partenaires stratégiques de la modernisation publique.
Les conditions de réussite
Cette transformation ne peut se faire ni seule, ni rapidement. Pour que les DRH puissent réellement assumer ce nouveau rôle stratégique, plusieurs conditions essentielles doivent être réunies.
Tout d’abord, la formation et la montée en compétences sont indispensables. Les professionnels RH n’ont pas vocation à devenir des experts techniques ou des data scientists, mais ils doivent acquérir une compréhension suffisante des systèmes d’intelligence artificielle. Il s’agit pour eux d’en maîtriser les mécanismes de base, d’en connaître les limites et d’adopter une lecture critique. Cette maîtrise leur permettra de dialoguer efficacement avec les DSI, d’interpréter les résultats produits par les algorithmes et de prendre des décisions éclairées. C’est dans ce rôle d’arbitre stratégique, à l’interface entre les données et les enjeux humains, que réside leur légitimité future.
Ensuite, la mise en place d’une gouvernance partagée devient incontournable. La fonction RH ne peut plus évoluer en vase clos. La structuration et la mise à jour des données doivent être le fruit d’un travail collectif impliquant les DSI, les managers de proximité et les agents eux-mêmes. C’est en rendant visible, explicite et collaborative la gestion des compétences que l’on pourra fiabiliser les données et garantir des analyses pertinentes. La qualité des résultats produits par l’IA générative dépend directement de la qualité des données saisies, mais aussi du dialogue entre les acteurs qui les utilisent.
Par ailleurs, l’introduction de l’IA générative dans les pratiques publiques appelle une acculturation progressive. Les craintes, souvent légitimes, doivent être reconnues et prises en compte. Il ne suffit pas de déployer un outil pour qu’il soit accepté. Il faut expliquer, former, rassurer. Cela suppose une pédagogie active, une transparence sur les usages et une communication claire sur ce que l’IAG peut réellement faire et surtout sur ce qu’elle ne peut pas faire. L’adhésion des agents passera par la confiance et cette confiance ne se décrète pas : elle se construit.
Enfin, aucune transformation ne sera légitime sans un respect rigoureux des principes éthiques et du cadre réglementaire. L’IAG ne doit jamais devenir une “boîte noire” dont les décisions seraient opaques ou arbitraires. Chaque recommandation algorithmique doit pouvoir être expliquée, discutée et contestée. Le respect du RGPD, l’encadrement prévu par le futur AI Act européen et les recommandations des autorités indépendantes comme la CNIL constituent des repères incontournables. C’est à cette condition que les usages de l’IA générative dans le secteur public pourront être acceptés, partagées et portées, par les professionnels comme par les usagers.
Conclusion
L’IA générative offre aux DRH des organisations publiques une opportunité unique : celle de sortir du carcan administratif pour jouer un rôle de partenaires de la transformation publique. Mais cette évolution n’est pas automatique. Elle exige un investissement massif dans la formation, la gouvernance des données et surtout dans l’accompagnement humain.
L’IA générative pourrait devenir un outil puissant, une sorte de catalyseur. Elle ne remplacera pas les DRH, mais leur donnera les moyens de redevenir des acteurs de premier plan dans la modernisation du service public.
L’avenir des compétences publiques dépendra de leur capacité à conjuguer intelligence artificielle et intelligence humaine, au service d’un même objectif : anticiper, sécuriser et valoriser les parcours professionnels des agents.
Par Amélie Battaini
Sources :
Baruel Bencherqui, D., Le Flanchec, A., & Mullenbach-Servayre, A. (2011).
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et son effet sur l’employabilité des salariés. Management & Avenir, p14–36.
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et son effet sur l’employabilité des salariés | Cairn.info
Rouilleault, H. (2007).
Anticiper et concerter les mutations. La Documentation Française.
Rapport Rouilleault : Anticiper et concerter les mutations
Chevalier, F., & Fournier, C. (2021).
Numérique et innovations pédagogiques en sciences de gestion : résultats de recherches. 13-28
Numérique et innovations pédagogiques en sciences de gestion : résultats de recherches | Cairn.info
Chevalier, F., & Dejoux C. (2020).
Intelligence artificielle et Management des ressources humaines: pratiques d’entreprises Intelligence artificielle et Management des ressources humaines: pratiques d’entreprises
Valenduc, G., & Vendramin, P. (2020).
Le travail dans l’économie digitale : continuités et ruptures. ETUI. WP 2016-03-économie digitale-web-version.pdf
CNFPT (2023).
Intelligence artificielle et services publics : quelle doctrine d’usage ? Intelligence artificielle et services publics : quelle doctrine d’usage ? – Labo
Cour des comptes (2023).
L’intelligence artificielle dans les politiques publiques : l’exemple du MEF. L’intelligence artificielle dans les politiques publiques : l’exemple du ministère de l’économie et des finances | Cour des comptes
Wirtz, B. (2019).
An integrated artificial intelligence framework for public management. An integrated artificial intelligence framework for public management: Public Management Review: Vol 21 , No 7 – Get Access
Lahlimi, N., Karim, K., & Wahbi, A. (2023).
La transformation digitale des organisations publiques : Approches théoriques et horizons innovants. International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics. La transformation digitale des organisations publiques: Approches théoriques et horizons innovants
Chevalier, F., & Kalika, M. (2020).
Personnalisation des parcours et IA : quelle place pour les RH ? Revue de Gestion des Ressources Humaines, 118, 79–90. Intelligence artificielle et Management des ressources humaines : pratiques d’entreprises – Archive ouverte HAL
Gérard Valenduc, Patricia Vendramin. (2020, November 05).
Le travail dans l’économie digitale : continuités et ruptures. In ETUI, The European Trade Union Institute. Retrieved 00:00, June 23, 2025, from https://www.etui.org/fr/publications/working-papers/le-travail-dans-l-economie-digitale-continuites-et-ruptures
Dubar, C. (2007).
La crise des identités : L’interprétation d’une mutation. Presses Universitaires de France. La crise des identités | Cairn.info
Dupuich-Rabasse, F. (2008).
Management et gestion des compétences. L’Harmattan. Management et gestion des compétences, Dupuich-Rabasse Françoise (Dir.). Paris, L’Harmattan, 2008, 258 p. Collection « Entreprises et Management » | Cairn.info
Joyeau, A., & Retour, D. (1999).
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences entre contrôle et autonomie. Revue de Gestion des Ressources Humaines, n°32. La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et son effet sur l’employabilité des salariés | Cairn.info
Image d’illustration : @storyset