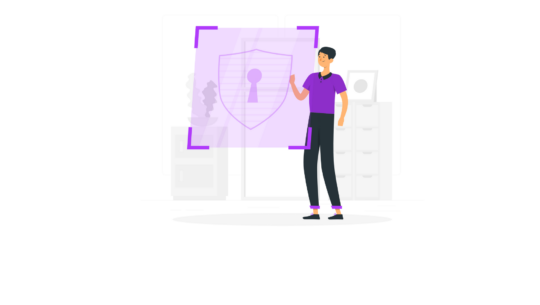Dans une grande collectivité, un(e) responsable RH se heurte chaque année au même constat : malgré les efforts pour établir un plan de formation et anticiper les départs, ses outils lui offrent surtout une photographie figée des compétences.
Sur le terrain, pourtant, les métiers évoluent à vive allure : les évolutions du numérique, les nouvelles attentes des usagers, les contraintes budgétaires. Comment, dès lors, transformer ce constat statique en un véritable outil d’anticipation et de mobilité ? C’est précisément le rôle que la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) est censée jouer.
Dans un contexte de transformation rapide des organisations publiques, la GPEC a plus que jamais besoin de devenir agile. Les attentes évoluent, les métiers se transforment, et les compétences doivent suivre. Pourtant, la GPEC traditionnelle peine encore à remplir son rôle d’anticipation. Et si l’intelligence artificielle générative pouvait changer la donne ?
Appuyée sur des données fiables, l’IA générative permet aujourd’hui d’aller au-delà de la planification classique pour construire une GPEC dynamique, capable d’éclairer les décisions RH avec précision. Concrètement, un agent administratif possédant des compétences en analyse de données pourrait être identifié par l’IA comme profil pertinent pour évoluer vers un poste de contrôle de gestion. L’outil ne se limite plus à décrire les compétences présentes, il propose des trajectoires plausibles et adaptées aux besoins de l’organisation. Encore faut-il que les bases soient solides : dans ce domaine, la qualité des données RH devient un facteur décisif.
GPEC traditionnelle : une cartographie figée dans un monde en mouvement
Dans la majorité des organisations publiques, la GPEC reste ancrée dans des logiques descendantes. Les référentiels sont rarement actualisés, et les plans de formation demeurent trop standardisés : ils peinent à intégrer les transformations accélérées des métiers, qu’il s’agisse de la numérisation des services, de la transition écologique ou encore de l’évolution démographique.
Cette inertie limite fortement la capacité à anticiper les besoins en compétences. Les talents sont sous-exploités, les passerelles de mobilité mal identifiées et les plans d’action souvent déconnectés des réalités terrain.
Résultat : la GPEC devient souvent un exercice formel, davantage une contrainte qu’un outil stratégique.
Pourtant, il est possible et même nécessaire de distinguer deux logiques complémentaires :
- La GPEC orientée agent/salarié : une approche opérationnelle, centrée sur l’individu, son développement de compétences et sa mobilité professionnelle. Elle répond aux aspirations personnelles et favorise l’employabilité.
- La GPEC orientée organisation : une approche résolument stratégique, visant à anticiper les besoins futurs, planifier les transformations et accompagner les évolutions structurelles. Elle sert de levier pour aligner les ressources humaines sur les priorités de l’organisation.
Le véritable enjeu consiste à combiner ces deux dimensions pour en faire un outil de dialogue et d’alignement entre les ambitions individuelles et les besoins collectifs, afin que la GPEC devienne un moteur de transformation plutôt qu’une contrainte administrative.
Vers une GPEC prédictive : l’IAG comme levier de transformation
À l’opposé de ce modèle figé, la GPEC prédictive proposerait une lecture dynamique des trajectoires professionnelles. L’IA générative permettrait d’identifier plus facilement des scénarios d’évolution, de croiser une plus grande quantité de données et ainsi de construire des parcours personnalisés.
Les outils d’IA analysent des volumes importants de données issues des systèmes RH, des plateformes de formation, ou encore des besoins en compétences du marché. Ils peuvent ainsi suggérer des recommandations ciblées en matière de mobilité, d’acquisition de compétences ou de recrutement. Cette approche transforme la gestion RH en un véritable levier de pilotage stratégique.
La donnée RH : un levier, un frein, un enjeu stratégique
Toutefois, une IA générative n’est performante que si les données qu’elle exploite sont fiables. Dans beaucoup de structures publiques, les bases de données RH ne sont pas régulièrement mises à jour et restent rarement centralisées, ce qui complique leur exploitation. Les informations disponibles sur les parcours, les compétences ou les formations existent bien, mais elles demeurent souvent cloisonnées et peu croisées. Sans actualisation ni consolidation, elles perdent rapidement en fiabilité et en utilité. Pire encore, lorsqu’une IA générative s’appuie sur des données lacunaires ou inexactes, elle peut passer à côté d’éléments essentiels, amplifier des biais ou même produire des « hallucinations » c’est-à-dire inventer des informations inexistantes. Un tel décalage fragilise les recommandations et réduit la confiance dans l’outil.
Cette situation freine l’émergence d’une GPEC prédictive.
Les prérequis d’une GPEC augmentée par l’IA générative
Pour passer d’une GPEC descriptive à une GPEC prédictive, plusieurs conditions doivent être réunies :
- Centraliser, structurer et fiabiliser les données RH existantes
- Créer une gouvernance partagée entre les fonctions RH et les systèmes d’information
- Garantir la transparence des traitements et le respect des cadres réglementaires applicables, qu’il s’agisse du RGPD pour les données personnelles, ou d’autres textes encadrant la gestion et l’ouverture des données publiques.
Avec ce socle, les outils d’IA générative implantés dans la GPEC peuvent alors produire de la valeur : cartographies de compétences, détection des écarts, scénarios de mobilité, recommandations de formation… autant de leviers pour une gestion proactive des ressources humaines.
Mais au-delà de la simple mise en place technique, ces prérequis appellent un véritable changement de culture organisationnelle. Il s’agit de passer d’une gestion administrative des données RH à une approche stratégique, dans laquelle chaque information collectée peut être mise au service d’un pilotage intelligent des compétences.
Cela suppose aussi de repenser la collaboration entre les acteurs : les RH ne peuvent plus travailler seules sur la question des compétences. Les DSI, les managers de proximité, les agents eux-mêmes doivent être associés pour garantir la qualité des données et la pertinence des scénarios envisagés.
Enfin, la dimension éthique ne doit pas être négligée, tout comme la dimension réglementaire. Des cadres comme l’IA Act, aux côtés d’autres réglementations nationales et européennes, imposent des obligations visant à garantir la transparence, la sécurité et la non-discrimination des systèmes d’IA. Ces règles ne sont pas seulement des contraintes : elles participent à la protection de l’éthique en fixant des limites légales à ne pas franchir. Dans le cadre d’une GPEC prédictive, cela implique que les recommandations issues de l’IA restent non seulement compréhensibles et justifiables, mais aussi juridiquement valides et conformes aux usages autorisés par la loi. L’enjeu est bien de renforcer la capacité d’action humaine grâce à la donnée, et non de la diluer dans des processus automatiques.
L’IA dans les administrations, c’est aussi la question de la transformation des pratiques professionnelles, détaillée dans l’article « L’IA générative dans les administrations : quels impacts réels sur les métiers et les compétences ? ». La convergence entre une GPEC prédictive et une IAG bien intégrée permettrait ainsi d’envisager une gestion des talents à la fois anticipatrice, éthique et alignée avec les besoins de transformation du service public.
La GPEC prédictive n’est pas une utopie, mais une ambition réaliste à condition d’investir dans la donnée
Dans le secteur public, la transformation RH ne pourra se faire sans une montée en puissance de la donnée. L’IA générative, bien utilisée, permet d’anticiper, de personnaliser et de fluidifier les parcours.
Mais cette promesse n’est accessible qu’à une condition : investir dans des fondations solides. L’avenir des compétences publiques se joue autant dans les outils technologiques que dans la capacité des organisations à structurer, gouverner et exploiter leurs données RH.
La GPEC prédictive n’est pas une rupture brutale avec le passé. C’est une évolution nécessaire, à la croisée de l’innovation technologique et de l’intelligence humaine. Et c’est aujourd’hui qu’elle se construit.
Par Amélie Battaini
Sources :
Baruel Bencherqui, D., Le Flanchec, A., & Mullenbach-Servayre, A. (2011).
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et son effet sur l’employabilité des salariés. Management & Avenir, p14–36.
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et son effet sur l’employabilité des salariés | Cairn.info
Rouilleault, H. (2007).
Anticiper et concerter les mutations. La Documentation Française.
Rapport Rouilleault : Anticiper et concerter les mutations
Chevalier, F., & Fournier, C. (2021).
Numérique et innovations pédagogiques en sciences de gestion : résultats de recherches. 13-28
Numérique et innovations pédagogiques en sciences de gestion : résultats de recherches | Cairn.info
Chevalier, F., & Dejoux C. (2020).
Intelligence artificielle et Management des ressources humaines: pratiques d’entreprises Intelligence artificielle et Management des ressources humaines: pratiques d’entreprises
Valenduc, G., & Vendramin, P. (2020).
Le travail dans l’économie digitale : continuités et ruptures. ETUI. WP 2016-03-économie digitale-web-version.pdf
CNFPT (2023).
Intelligence artificielle et services publics : quelle doctrine d’usage ? Intelligence artificielle et services publics : quelle doctrine d’usage ? – Labo
Cour des comptes (2023).
L’intelligence artificielle dans les politiques publiques : l’exemple du MEF. L’intelligence artificielle dans les politiques publiques : l’exemple du ministère de l’économie et des finances | Cour des comptes
Wirtz, B. (2019).
An integrated artificial intelligence framework for public management. An integrated artificial intelligence framework for public management: Public Management Review: Vol 21 , No 7 – Get Access
Lahlimi, N., Karim, K., & Wahbi, A. (2023).
La transformation digitale des organisations publiques : Approches théoriques et horizons innovants. International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics. La transformation digitale des organisations publiques: Approches théoriques et horizons innovants
Image d’illustration : @storyset